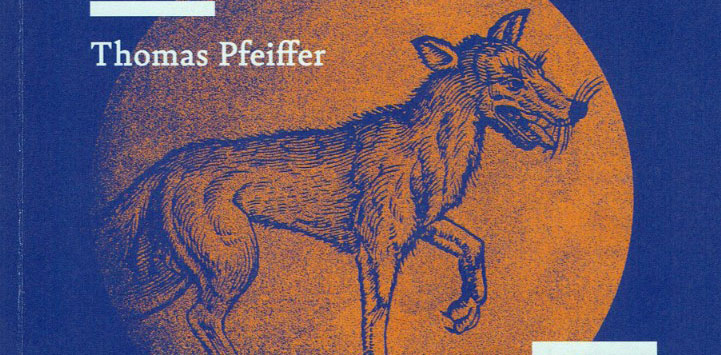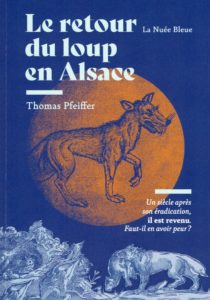![[Communiqué de presse] Pollution de l’air en France : une troisième condamnation pour l’État](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2022/10/children-et-energies-fossiles-768x512-1.jpg)
mardi 18 Oct 2022 | A la une, Alsace, Communiqués de presse, Pollutions et santé, Presse
Paris, le 17 octobre 2022 – Le Conseil d’État condamne une nouvelle fois l’État à payer une astreinte de 10 millions d’euros par semestre pour avoir encore manqué à ses obligations de lutte contre la pollution de l’air. Malgré une première condamnation en 2017, l’histoire se répète, au détriment de la santé des personnes et de l’environnement, puisque les normes de qualité de l’air ne sont toujours pas respectées dans les plus grandes agglomérations françaises. Heureusement, le Conseil d’État maintient une pression très forte sur l’État pour le contraindre à agir.
Cette décision s’inscrit dans une bataille judiciaire initiée il y a plus de 10 ans et marquée par une première grande victoire, le 12 juillet 2017, puisque le Conseil d’État avait condamné l’inaction de l’État concernant la problématique majeure de la pollution de l’air. Face à l’inertie étatique, les Amis de la Terre France et 77 co-requérants ont de nouveau saisi la juridiction suprême afin qu’elle ordonne à l’État de respecter sa décision de 2017 ; ce qu’elle a fait le 10 juillet 2020. Cette décision avait pour but d’enjoindre à l’État de respecter ses obligations sur la pollution de l’air, sous peine d’avoir à payer une astreinte historique de 10 millions d’euros par semestre de retard. L’État n’ayant toujours pas agi un an plus tard, le 4 août 2021, les juges administratifs ont mis leur menace à exécution : l’État a été condamné à verser 10 millions d’euros à plusieurs établissements publics et structures agréées de surveillance de la qualité de l’air dans les zones concernées.
Considérant que la décision n’était toujours pas respectée, les Amis de la Terre France et les autres associations ne lâchent pas et demandent toujours au Conseil d’État de condamner l’État au paiement de l’astreinte. Dans la décision rendue aujourd’hui, le Conseil d’État devait donc évaluer si, pour les deux semestres passés, l’État avait enfin respecté ses obligations. Cela n’est malheureusement pas le cas : trois zones dépassent toujours le seuil autorisé pour le dioxyde d’azote [Note numero=1] tandis que pour la ville de Toulouse, la baisse du niveau de polluant en dessous du seuil ne peut être regardée comme « suffisamment consolidée ».
Les juges n’ont pas été convaincus par l’argument du ministère de la transition écologique selon lequel l’État avait pris les mesures nécessaires pour améliorer suffisamment la qualité de l’air, notant au contraire l’insuffisance des mesures mises en place. Lutter contre la pollution de l’air est pourtant une mesure sociale essentielle, puisque les personnes les plus vulnérables sont les plus exposées à la pollution [Note numero 2]. En effet, si le nombre de morts prématurées imputables à la pollution de l’air s’élève à environ 100 000 par an [Note numero 3], les enfants sont les premières victimes des effets des polluants dans l’air [Note numero 4]. Il est d’ailleurs prouvé que la mise en place de Zones de Faible Emissions (ZFE) diminue les pathologies chez les enfants [Note numero 5].
Les juges constatent que l’État n’a pas respecté ses engagements européens dans quatre villes de France. Ils rappellent que, même si certaines améliorations ont été constatées, « la période de dépassement des valeurs limites dans les zones concernées' » continue, malgré les condamnations.
Selon Louis Cofflard, l’avocat des associations, « cette décision était malheureusement prévisible ; l’Etat se montre en réalité récalcitrant et n’a pas souhaité se conformer aussi rapidement que possible à la décision obtenue il y a plus de cinq ans. ».
Dans le prolongement de cet arrêt, d’autres batailles judiciaires sont gagnées au nom de la protection de la qualité de l’air. Très récemment, France Nature Environnement Paris et Les Amis de la Terre Paris ont permis d’éviter la construction de bâtiments enjambant le boulevard périphérique. Ces projets condamnaient des personnes à vivre dans des niveaux de pollution dangereux pour la santé [Note numero 6].
En 2023, le Conseil d’État réexaminera à nouveau si l’État remplit ses obligations. Les Amis de la Terre France et leurs soutiens espèrent que ce sera le cas et que le juges constateront une diminution drastique des polluants dans l’air.
Notes de bas de page :
Note 1 : Lyon, Paris, Aix-Marseille, et Toulouse.
Note 2 : Pollution: Les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables sont les plus exposées, 20 minutes, 5 février 2019
Note 3 : La pollution de l’air provoquerait près de 100.000 morts prématurées par an en France, Le Figaro, 9 février 2021
Note 4 : Les enfants, premières victimes de la pollution de l’air, Reporterre, 2 mars 2021
Note 5 : Les bénéfices pour la santé des zones à faibles émissions, Le Monde, 2 octobre 2022
Note 6 : Paris : l’annulation de permis de construire au-dessus du périphérique est confirmée, Le Parisien.
Liste des co-signataires de ce communiqué de presse :
- ACTénergies association varoise
- Alofa Tuvalu
- Alerte Nuisances Aériennes
- Alsace Nature
- Amis de la Terre Paris
- Amis de la Terre Val de Bièvre
- Association DRAPO
- Association de défense contre les nuisances aériennes (ADVOCNAR)
- Association de Concertation et de Proposition pour l’Aménagement et le Transport (ACPAT)
- Association Nature du Nogentais
- Association de Protection des Collines Peypinoises (APCP)
- Champagne Ardenne Nature Environnement
- CIRENA
- Collectif contre les nuisances aériennes de l’agglomération toulousaine (CCNAAT)
- Collectif des Riverains de l’Aéroport Saint Exupéry (CORIAS)
- COVIFER
- Défense des intérêts des riverains de l’aérodrome de Pontoise-Corneilles en Vexin (DIRAP)
- DRAPO DÉFENSE DES RIVERAINS DE L’AÉROPORT DE PARIS-ORLY
- Environnement 92
- Fédération Fracture
- France Nature Environnement Ile-de-France
- France Nature Environnement Bouches-du-Rhône
- France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur
- France Nature Environnement Paris
- Greenpeace France
- Notre Affaire à Tous (NAAT)
- Nord Ecologie Conseil
- OYE349
- SOS Paris
- Union française contre les nuisances des aéronefs (UFCNA)
- Union Calanques Littoral
- Val-de-Seine Vert
![[Communiqué de Presse] STOCAMINE : NOUVEAU REVERS POUR L’ÉTAT](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2021/01/stocamine.jpg)
lundi 3 Oct 2022 | A la une, Communiqués de presse, Déchets, Eau et zones humides, GL M2A, Groupes Locaux, Nappe phréatique, Pollutions et santé, Presse, Revue de presse, Risques industriels
Par deux décisions du 28 septembre 2022 (n°459524 et 459379), la 6ème chambre du Conseil d’État a donné tort au Ministère de la Transition Écologique et à la Société MDPA en rejetant les pourvois formés contre l’arrêt du 15 octobre 2021 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy, qui avait annulé l’autorisation d’enfouissement définitif des déchets dangereux à Stocamine.
Pour rappel, la Cour Administrative d’Appel de Nancy avait prononcé, en octobre 2021, l’annulation du jugement du 5 juin 2019 du Tribunal Administratif de Strasbourg ainsi que de l’arrêté préfectoral du 23 mars 2017 qui autorisaient l’enfouissement définitif de plus de 40 000 tonnes de déchets toxiques. Cette annulation se basait principalement sur l’absence de garanties financières apportées par les MDPA.
La décision du Conseil d’État intervient suite à la contestation formée par l’État de contrer la décision de la Cour Administrative d’Appel de Nancy. Le Conseil d’État a estimé que les arguments soulevés par l’État consistant à considérer que la décision de la Cour d’appel reposait sur un vice de procédure (défaut de capacité et de garantie financière) « n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ».
L’annulation d’autorisation d’enfouissement des déchets devient de ce fait définitive. Le Préfet du Haut-Rhin est contraint de mettre à nouveau en œuvre une procédure d’évaluation environnementale, bien malgré lui et alors qu’avaient été tentés plusieurs contournements de cette décision de justice :
- par amendement à la loi de finance considérée comme inconstitutionnelle par décision du Conseil Constitutionnel du 28 décembre 2021 N°2021-833
- en prenant un arrêté de mise en demeure (normalement destiné à prendre des mesures conservatoires), mais détourné ici pour permettre la construction des travaux de barrages en béton et le remblayage du bloc 15 ayant pris feu en 2002 (et alors qu’une enquête pénale diligentée par Alsace Nature est toujours en cours pour essayer de déterminer la composition exacte des déchets stockés dans la mine) : ces travaux ont été suspendus par ordonnance du Tribunal Administratif du 25 mai 2022 ;
- en tentant de passer en force contre cette suspension pour continuer la construction de 3 barrages en béton : travaux non autorisés suite à l’ordonnance du Tribunal Administratif de Strasbourg du 1er août 2022.
Il s’agit d’une défaite de plus pour les MDPA et l’État dans ce dossier à rebondissement. Et Alsace Nature maintiendra son devoir de vigilance environnementale pour l’autorisation à venir.
REVUE DE PRESSE

jeudi 29 Sep 2022 | A la une, Agriculture et Alimentation, Agriculture et nature vivante, Eau et zones humides, Nappe phréatique, Pollutions et santé, Rhin et Milieux alluviaux
L’été 2022 aura marqué les esprits par l’absence de précipitations, des températures très élevées, des cours d’eau totalement secs, des incendies etc.
Ces phénomènes, qui préfigurent les conséquences du dérèglement climatique que nous aurons à vivre demain, ne doivent plus être considérés comme « exceptionnels » mais ils vont être de plus en plus la « norme » et doivent interpeller les décideurs sur le changement de cap vital qui est nécessaire.
L’Alsace a longtemps été considérée comme étant à l’abri d’éventuels manques d’eau, car bénéficiant d’une ressource en eau inépuisable… avec une nappe phréatique de 35 milliard de m3. Pourtant, l’été que nous venons de vivre nous a montré l’impact d’une sécheresse sur l’ensemble du fonctionnement de notre société : cours d’eau à sec (et l’ensemble des services rendus par la nature qui disparaissent), industrie impactée, mobilité fluviale contrariée, restrictions pour les citoyens, etc.
Pendant la sécheresse où nous avons été les seuls à plaider pour une réflexion globale sur la situation (révision de l’arrêté cadre de 2012, le juste partage de la ressource eau, le changement de modèle agricole, le retour des cultures vivrières, etc.), pendant que l’Etat fermait les yeux sur les véritables responsables des déséquilibres quantitatifs.
Mais, au-delà des nouveaux problèmes quantitatifs et de partage de la ressource, une ancienne menace refait surface, moins médiatisée, mais que nous avons souvent dénoncée au cours des dernières années. Celle de la qualité de l’eau de la nappe phréatique d’Alsace !

En effet, depuis le mois de juin les préfets signent des arrêtés « portant dérogation pour la distribution d’une eau ne répondant pas à des limites de qualité réglementaires fixées pour les eaux destinées à la consommation humaine ».
Ce n’est pas un, ni deux arrêtés qui sont signés mais déjà une dizaine et d’autres sont en préparation. (Plusieurs centaines de milliers de consommateurs sont concernés).
Derrière ce jargon administratif se cache une réalité toute simple : les distributeurs d’eau sont autorisés pour 3 ans (renouvelables) à distribuer une eau qui va au-delà des limites de conformité !
Or, les molécules concernées sont issues de désherbants[1] (métolachlore ESA, métolachlore NOA, chloridazone dephenyl), autant dire un produit « de confort » pour l’agriculture, et personne ne découvre le problème. Bien au contraire, nous n’avons eu de cesse de demander des mesures de restrictions ces dernières années mais il a été préféré des mesures basées sur « le volontariat ». Nous en voyons aujourd’hui les effets de l’argent public a été injecté dans des mesures sans grands résultats et nous sommes très loin du principe fondateur : Pollueur/Payeur de gestion de l’eau.
C’est un véritable scandale dans l’indifférence la plus totale des pouvoirs publics.
Nous refusons cet état de fait ! Nous avons porté, et nous porterons devant les juridictions compétentes l’ensemble des arrêtés dérogatoires qui seront signés tant qu’un programme d’interdiction de ces molécules ne sera pas mis en œuvre. Il est possible de cultiver et de produire sans désherbant !
Plus largement l’inertie de l’Etat à prendre des mesures coercitives alors que la situation n’a fait que se dégrader depuis des décennies, est aujourd’hui à questionner. La fonction de l’Etat n’est-elle pas justement de protéger les biens communs et les ressources vitales pour les citoyens ? Est-il acceptable que ce soit le consommateur qui, au travers de sa facture d’eau, paye une dépollution largement évitable ?
Pour que nous puissions engager toutes les mesures nécessaires à faire entendre la voix des citoyens d’aujourd’hui et de demain, nous avons besoin de vous tous : dès maintenant faites un don pour sauver la nappe d’Alsace qui nous fournit 75% de notre eau qui doit être potable sans traitements !
FAIRE UN DON
[1] Les molécules concernées sont issues d’un désherbant utilisé en agriculture notamment pour le maïs et la betterave. Ce produit, commercialisé sous l’appellation S-Metolachlore se transforme dans le sol en métabolites (petites molécules issue du composé original). Ces dernière sont nommées métolachlore ESA et métolachlore NOA pour celles qui nous concernent
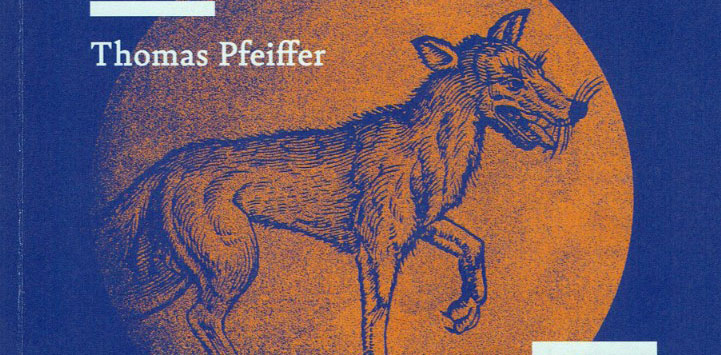
jeudi 1 Sep 2022 | A la une, Nature
Dans un ouvrage militant et savant (il s’agit d’une deuxième édition mise à jour), Thomas Pfeiffer nous propose un voyage dans le temps et le présent avec le loup en Alsace. En quatre parties, agrémentées de deux cahiers photos, on y apprend beaucoup de choses, sur la biologie du loup, mais surtout sur les rapports que nous humains entretenons avec cet animal fascinant à bien des égards.
Les parties historiques rendent compte avec force détails, quelques fois de manière un peu confuse, de la longue guerre que les humains ont livrée au loup jusqu’à son extermination complète en France en en Alsace. On constate que si des loups enragés ont pu causer des ennuis sérieux dans certains cas, les campagnes de destruction systématiques ont plutôt servi des motifs idéologiques (le loup « diabolisé » comme les sorcières ou les juifs), économiques (les primes au loup constituent des subsides non négligeables dans les campagnes) ou de domination sociale (le loup bouc émissaire pour détourner l’attention des populations). L’auteur suggère avec finesse que si le loup était aussi dangereux qu’on le prétend, les captures et destructions n’auraient pu être aussi aisées, y compris quelquefois par des enfants !
Un inventaire des toponymes et des contes et légendes complète l’examen des traces culturelles laissées par le loup en Alsace… jusqu’à son retour dans notre réalité actuelle. A propos du retour spontané du loup en France et en Alsace, Thomas Pfeiffer pose la question de ce que le loup révèle de notre rapport à la nature dans un contexte de maîtrise et de domination. Dans son plaidoyer pour une cohabitation pacifique entre humains et loups, il propose de s’appuyer sur le retour du loup pour réviser nos politiques agricoles et forestières, plutôt que d’en faire un bouc émissaire facile et de ne rien changer à un modèle de toute façon à bout de souffle.
En bref, voici un ouvrage fort intéressant, documenté et engagé, que liront avec intérêt les naturalistes et amis de la nature, mais aussi tous les acteurs qui ont en charge la gestion des espaces ruraux.
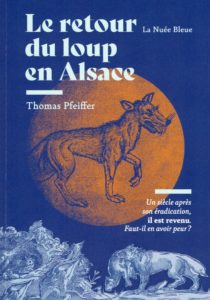
Pfeiffer, Thomas, 2021, Le retour du loup en Alsace, Ed. La Nuée Bleue, Strasbourg 227 pages

lundi 1 Août 2022 | Agriculture et Alimentation, Agriculture et nature vivante, Eau et zones humides, Nappe phréatique, Réseaux Thématiques
Dans une note de proposition pour l’évolution de la HVE en janvier 2021, France Nature environnement soulignait que les critères de certification n’offraient pas une solidité suffisante pour permettre de réels impacts sur l’environnement et que la thématique climat n’était pas abordée alors qu’un certain nombre d’indicateurs pertinents pouvaient être proposées sur cet enjeu majeur
Il revient donc de s’interroger sur les réels objectifs de cette certification
Il ne nous parait pas inutile de rappeler les principes de l’agroécologie : l’agroécologie est un rapprochement de l’agronomie et de l’écologie ; elle vise à cultiver et entretenir des agrosystèmes qui s’inspirent des fonctionnalités des écosystèmes naturels. L’objectif principal de l’agroécologie est de lutter contre la dégradation des sols agraires, ou de favoriser la régénération des sols dégradés, pour en augmenter les capacités de production ; mais aussi, de sauvegarder la qualité des eaux et de l’air.
Introduire dans cette certification HVE des items et indicateurs en référence à l’agro écologie ne peut être que positif, mais à condition qu’elle impose des valeurs quantitatives et qualitatifs beaucoup plus ambitieuses. Ce label, en « trompe œil » pour les consommateurs, les riverains des zones agricoles, n’apporte pas la garantie d’une alimentation saine et d’un cadre de vie sans produits phytosanitaires chimiques. Il s’agit là d’un point de désaccord profond avec les valeurs de l’agriculture biologique et de l’agroécologie. Les intérêts économiques que procurent cette certification (réduction d’impôt, subventions, démarche commerciale…) ne devraient être qu’une motivation mineure pour les requérants, l’urgence climatique, l’urgence de préserver des ressources naturelles et notamment l’eau en cette période de grande sécheresse, l’urgence de sauver la biodiversité devraient être le point de mire. Or les exigences présentées ne sont pas à la hauteur des enjeux. Il en revient donc de proposer : soit de modifier les critères et indicateurs de notation, et les rendre plus pertinent, soit de changer d’intitulé de cette certification en proposant : « basse valeur environnementale »
Projet d’arrêté HVE niveau 3
Produits phytosanitaires
Pour obtenir la validation du niveau 3 HVE, l’exploitant agricole pourra sans contrainte poursuivre l’épandage de produits phytosanitaires chimiques, le projet d’arrêté prévoit toutefois quelques nuances pour les CMR 1 (sauf dérogation) et pour les CMR 2, mais les utilisateurs ne seront pas pénalisés pour leur certification. L’utilisation de néonicotinoïdes et de tous CMR (Cancérogènes, Mutagènes et Reprotoxiques) qui polluent le sol, l’air et l’eau et nuisent au maintien et au développement de la biodiversité mérite une disqualification et un retrait du label.
Si ce label « Haute valeur environnementale » avait une réelle valeur environnementale, il aurait été avant tout nécessaire d’imposer aux utilisateurs une réduction drastique et un arrêt progressif de l’utilisation de produits chimiques, en présentant un calendrier et des modalités d’engagement pour y parvenir. Des points devraient être validés pour des utilisateurs de produits en biocontrôles. A l’heure où les autorités publiques signent des dérogations pour une utilisation de l’eau qui dépasse les normes de pollutions cumulées notamment aux herbicides (exemple le S-métholachlore), les critères d’acceptabilité de l’utilisation d’herbicides devraient être plus sélectifs et bien plus contraignants, alors que des méthodes de substitution existent. Cette pollution constitue un grand danger pour la santé humaine et les milieux naturelles et aquatiques, elle doit être stoppée. Ce label doit y contribuer.
Alsace Nature s’associe aux demandes de France Nature Environnement que la HVE se fixe pour objectif :
- La diminution de l’emploi des pesticides par des stratégies prophylactiques et agronomiques,
- L’utilisation du biocontrôle,
- L’interdiction des pesticides les plus dangereux avec des phrases de mention danger,
- La surveillance des parcelles pour décider des traitements en fonction des besoins phytosanitaires fait partie des bonnes pratiques et des obligations réglementaires inscrite dans la majorité des Autorisations de Mises sur le Marché (AMM).
Conditions d’application des traitements et la fertilisation des sols
Il conviendrait de décliner beaucoup plus d’indicateurs pour l’utilisation de méthodes et d’outils agricoles alternatifs aux produits chimiques, et plus particulièrement au niveau des grandes cultures. Des techniques existent, des expérimentations montrent leur efficacité, des soutiens financiers sont prévus. Incompréhensible pour notre fédération d’associations environnementales, que ce label HVE n’en fasse pas la promotion et n’encourage pas les agriculteurs à les employer. L’introduction des légumineuses dans la rotation, les cultures intermédiaires ou la couverture des sols devraient être obligatoire. La déclinaison de critères qualitatifs d’analyse des sols et le taux d’humus permettrait de vérifier et de suivre les évolutions culturales des exploitations labélisées. L’absence de telles pratiques et matériels devrait être noté 0 et être éliminatoire.
Gestion de l’irrigation
La notation sur la gestion de l’irrigation doit se faire au regard des pratiques agricoles qui favorisent le maintien d’une couverture des sols et de haies et de bosquets. Des limites de prélèvement de l’eau en période de sécheresse et en étiage doivent être fixées, notamment pour des grandes cultures comme le maïs.
Devant l’urgence climatique, nous sollicitons fortement l’introduction d’un indicateur Climat, avec des ITEM spécifiques qui évalue l’émission des GES et favorise leur diminution.
![[Communiqué de presse] Pollution de l’air en France : une troisième condamnation pour l’État](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2022/10/children-et-energies-fossiles-768x512-1.jpg)

![[Communiqué de Presse] STOCAMINE : NOUVEAU REVERS POUR L’ÉTAT](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2021/01/stocamine.jpg)