
vendredi 4 Sep 2020 | A la une, Agriculture et Alimentation, Aménagement du territoire, Déchets, Eau et zones humides, Energies Climat, Forêt, Nature, Pollutions et santé, Réseaux Thématiques
ALSACE NATURE vous invite au festival des 10 jours VERT le Futur, organisé par une poignée de bénévoles passionnés, en partenariat avec plusieurs associations (dont Alsace Nature) et la commune de Kolbsheim
« Cette année 2020 porte l’espoir d’une prise de conscience et de la construction d’un soit-disant monde d’après.
Avec 10 jours VERT le futur, nous vous invitons à penser et imaginer le monde de maintenant !
Ce que nous faisons du présent détermine les sourires ou les larmes de demain. Ça commence par là, maintenant, localement et ensemble, découvrir, partager, s’émerveiller.
C’est l’esprit du rendez-vous que nous vous fixons du 10 au 20 septembre à Kolbsheim.
Là où s’est concentrée une partie de la lutte contre la construction d’une autoroute, alors que les travaux de celle-ci ont repris intensément à l’aube du déconfinement, il s’agit, aujourd’hui, de
construire des déviations imaginaires qui deviendront la réalité du futur.
Dix jours pour réfléchir et infléchir le monde de maintenant et découvrir des films passionnants, des conférences et des débats constructifs, des expositions vivifiantes, des concerts sous les arbres, des spectacles dans la rue et dans les champs… »
Voir le Programme des 10 jours VERT le Futur
— appel à bénévoles —-
Nous recherchons des volontaires pour aider lors des différents événements : accueil pour respect des consignes COVID, stands vente goodies, installation/rangement matériel …
Si vous êtes disponible 1heure, 2 heures ou + lors de ces 10 jours, merci de nous envoyer un mail à actu@alsacenature.org, nous reprendrons contact avec vous pour les détails pratiques.
Merci d’avance pour votre soutien !!
Pourquoi ces 10 jours ?
Pourquoi ces dates ?
Pourquoi Kolbsheim ?
Pourquoi tant de vert ?…
10 septembre 2018 – 20 septembre 2017 Vert le Futur…
Sans détour, mais sur des chemins de traverse, c’est l’indéfectible force d’une lutte citoyenne contre un projet autoroutier d’un autre âge (le Grand Contournement Ouest de Strasbourg) et l’engagement pour la préservation de notre planète qui sont le socle des 10 jours VERT le Futur.
Sans conteste, mais avec immense chagrin, Kolbsheim puis Vendenheim ont perdu leurs forêts manu militari à l’aube du 10 septembre 2018. Les pelleteuses sont aujourd’hui à l’œuvre. La poussière vole. Les arbres sont tombés comme des allumettes sur tout le tracé de l’autoroute et le béton envahit à une vitesse folle la couronne verte de Strasbourg.
Sans violence, mais avec autant de ferveur que de persévérance, la mobilisation citoyenne contre l’ineptie du GCO a été incroyablement inventive, généré de formidables échanges humains, créé des solidarités, provoqué d’improbables rencontres. Digne autant qu’indignée, bien souvent joyeuse, elle a défié l’injustice et la matraque.
Une lutte courageuse qui a secoué les consciences, bousculé l’ordre établi et fait reculer les machines le 20 septembre 2017 !
à Kolbsheim où la protection de la forêt a marqué le combat contre l’autoroute, un petit collectif venu d’ici et d’ailleurs s’est formé avec l’idée que toutes les énergies déployées pour faire trembler les géants et sauver les arbres ont bel et bien un avenir. Ne pas s’en tenir à la tristesse et perpétuer la mise en commun de nos espoirs, de nos initiatives, de nos actions pour transformer le monde, avec nos armes : l’imagination, la culture, l’art, la réflexion.
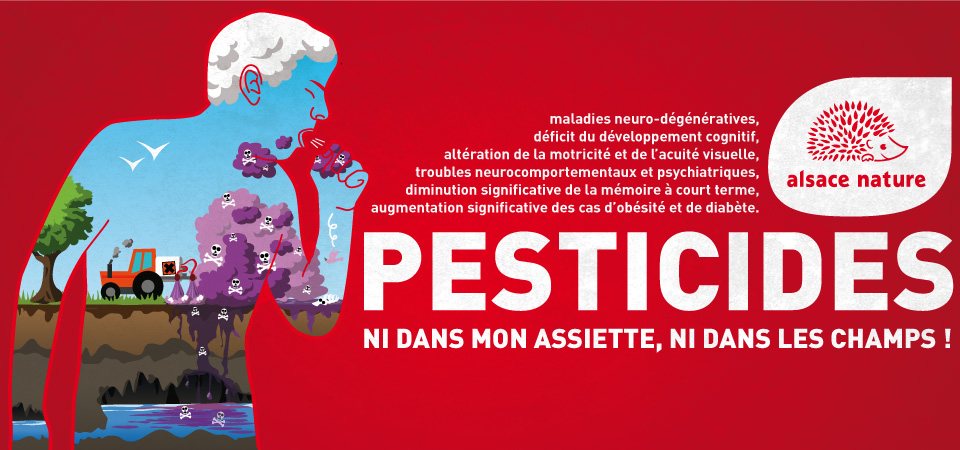
mardi 11 Août 2020 | A la une, Agriculture et Alimentation, Pollutions et santé, Réseaux Thématiques
En date du 23 juillet 2020 la Chambre d’Agriculture a ouvert une consultation intitulée « agriculteurs, vignerons et villageois d’Alsace – charte d’engagement pour bien vivre ensemble » en application de l’article 1 du décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019. Ce projet de charte élaborée par la Chambre d’Agriculture d’Alsace avec l’Association des Viticulteurs d’Alsace, les FDSEA et les Jeunes Agriculteurs des deux départements alsaciens se veut être un document susceptible de rassurer les riverains qui vivent à proximité de terres cultivées, et qui s’inquiètent des effets des épandages de pesticides sur leur santé.
Les pesticides chimiques (terme plus approprié que produits phytopharmaceutiques ou phytosanitaires) constituent un danger pour la santé des personnes (effets toxiques respiratoires, neurologiques, allergiques, effets cancérigènes, mutagènes, toxiques pour le foetus, perturbation endocrinienne…) que ce soit par la substance active elle-même ou des résidus, métabolites, adjuvants et cocktails dont les effets sont très mal connus et absolument pas maîtrisés. Ils portent aussi dommage à l’écosystème. La proximité des épandages de 3 à 20 m des habitations et des espaces privés ne protège nullement les résidents ou les personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013.
Cette consultation ouverte jusqu’au 23 août 2020 intervient en pleine période de vacances estivales et à une période où la grande saison des épandages est terminée. Nous relevons que l’information officielle, publiée et parue dans la presse locale le jour même du lancement, annonce une concertation en ligne jusqu’au 28 août. Si cette concertation était réellement « conçue un peu comme une démarche participative », des mesures plus opportunes en termes de délais, de communication et de concertation auraient pu être prises.
En effet, nous regrettons que la dynamique engagée par la filière viticole lors des deux réunions préparatoires en mars et décembre 2019, qui avait notamment comme ambition de mettre autour de la table au côté des viticulteurs, des collectivités locales et territoriales, des services et organismes publics et des associations n’ait pas été poursuivie et développée.
A la sortie d’une période d’inquiétude et d’angoisse pour les citoyens, et compte tenu des conséquences reconnues de l’épandage de pesticides sur la santé des personnes, la biodiversité, l’air, l’eau, une démarche innovante d’échanges, de discussions et de dialogue aurait été une belle occasion de concertation pour notre région. Ce texte qui est le résultat de deux démarches menées en parallèle n’est pas satisfaisant…
Alsace Nature invite l’ensemble de la population alsacienne à participer à cette consultation publique. Pour ce faire, nous mettons à votre disposition ci-dessous en téléchargement, le document reprenant nos observations et contributions.
Document des observations et contributions – Alsace Nature (PDF – 160 Ko)
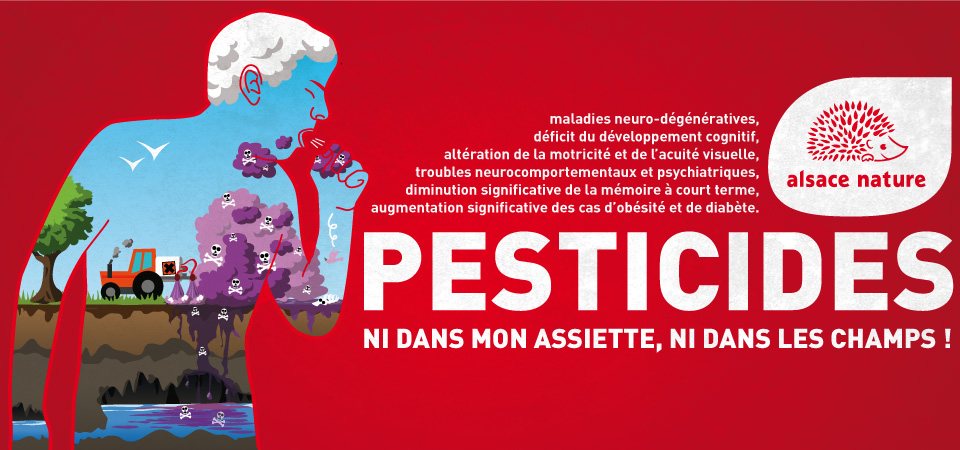
jeudi 30 Juil 2020 | A la une, Agriculture et Alimentation, Agriculture et nature vivante, Alsace, Pollutions et santé, Réseaux Thématiques
Vous habitez en milieu rural ou en milieu urbain à proximité d’un champ cultivé et vous vous inquiétez de l’impact des pesticides sur les riverains ?
Cette consultation est pour vous. Elle est ouverte sur le site de la Chambre d’agriculture d’Alsace jusqu’au 23 août 2020 : https://alsace.chambre-agriculture.fr/charte-dengagement/ . Participez !
Quel est l’enjeu ?
La loi prévoit pour la première fois des distances entre traitements pesticides et les espaces habités. Ces distances peuvent être réduites si les agriculteurs s’engagent dans une « Charte » départementale, soumise à consultation et à valider par le Préfet, le tout selon certaines règles définies par un décret du 27 décembre 2019. L’objectif affiché est de « bien vivre ensemble ».
Si Alsace Nature apprécie que de nombreux agriculteurs et en particulier viticulteurs s’orientent vers l’agriculture biologique qui utilise des produits relativement peu préoccupants.
Par contre, Alsace Nature n’apprécie guère que la profession agricole propose une charte qui n’a comme seule finalité que de faire de la communication, en affichant des engagements qui ne sont que des dispositions légales et qui n’aura comme seul effet que de réduire les zones de non traitement.
La protection des riverains est notre priorité, mais cette charte essaie de refiler la charge des Zones de Non Traitement aux riverains. Deux principes sont à défendre : le respect de la propriété et du Pollueur=payeur !
Alsace Nature publiera prochainement sa contribution, en cours de rédaction, mais vous invite dès à présent de participer en apportant votre contribution.
En attendant, vous pouvez consulter la fiche technique d’Alsace Nature sur les Chartes, la protection des riverains et les Zones de Non Traitement qui vous présente une synthèse du cadre réglementaire de la charte, notre position et des références documentaires.
Télécharger la Fiche Technique – PDF
Vous pourrez également nos faire parvenir une copie de votre contribution à agriculture@alsace-nature.org.

mardi 2 Juin 2020 | Agriculture et Alimentation, GL EMS, Nature, Réseaux Thématiques
Nous savions que le modèle de développement issu des valeurs du XXème siècle devait se reformer en raison de ses impacts néfastes sur l’ environnement. (postulat de la croissance économique, accaparement illimité des ressources naturelles…)
La crise sanitaire récente a marqué un arrêt brutal à cette fuite en avant de nos comportements individuels et collectifs.
Elle aura probablement favorisé, espérons-le du moins, une prise de conscience pour beaucoup de l’idée tant de fois reprise par les écologistes, que nous allions “droit dans le mur.”
Aujourd’hui cette phase d’arrêt doit nous conduire à exercer enfin un virage salvateur dans nos modes de production et de consommation et à renoncer à notre attitude prédatrice vis-à-vis des ressources que nous offre la planète.
L’OMS annonce que le virus pourrait persister plusieurs années; il est donc illusoire de penser reprendre le même modèle de développement basé sur une mondialisation effrénée.
Il paraît de plus en plus clair en outre que la destruction des écosystèmes contribue, parmi ses nombreuses conséquences dramatiques pour l’environnement et donc pour l’Humanité, à multiplier les épisodes d’épidémies.
Cependant pour que ce changement de cap soit vraiment significatif, nous, Association de Protection Nature Environnement (APNE), avons un rôle majeur à jouer.
Ce travail nous l’avons commencé depuis bien longtemps, mais nos propositions n’ont pas suffisamment été prises en compte par les décideurs politiques.
En tant groupe local de EMS, nous avons souhaité réagir à partir de nos premières impressions “post-confinement”.
Quels constats après deux mois de confinement?
Parmi les mesures prises durant le confinement par les pouvoirs publics à Strasbourg pour contrer la propagation du virus, figure la fermeture des parcs, espaces verts publics et berges de l’Ill. La limitation des déplacements à 1km autour de son domicile a interdit par ailleurs de se rendre en forêt ou en montagne.
Ces mesures ont accentué l’effet de stress occasionné pour un grand nombre personnes par la disparition du rythme de vie habituel, l’impossibilité de sortir librement, la limitation des contacts humains. Nombreux sont ceux qui ont réclamé la réouverture des parcs et la possibilité d’aller marcher à la campagne. Les agents immobiliers ont paraît-il reçu de très nombreuses demandes de personnes souhaitant déménager hors des villes, « se mettre au vert » !
L’expérience que nous venons de vivre aura mis en évidence l’utilité pour les citadins de l’accès à la nature pour leur santé physique et mentale.
De nombreux témoignages et articles ont montré partout dans le monde des animaux sauvages s’approprier en quelques temps des espaces jusqu’alors occupés ou visités par l’Homme.
Tous peuvent ont pu constater l’amélioration de la qualité de l’air et le bénéfice que procure la baisse de la pollution sonore.
Cela démontre que si nous voulons reconquérir de la biodiversité dans nos villes, la place de l’humain sera à redéfinir dans certains espaces… en apprenant par exemple à respecter les habitats, périodes de reproduction de la faune locale.
Le rôle des APNE est certes de sensibiliser le grand public par la connaissance de ces enjeux.
Nous devons en outre être en mesure, même sur un territoire densément peuplé comme l’Eurométropole de Strasbourg (EMS), d’identifier des espaces qui doivent rester indemnes de toute activité humaine. (réserves intégrales dans les forêts urbaine,des TVB protégées etc…)
Lire Le communiqué de presse de FNE :
En raison d’une gestion des espaces verts en sursis, chacun a pu constater que la nature pouvait à nouveau s’exprimer plus librement.
Dans les jours mêmes qui ont suivi le dé-confinement, les machines “d’entretien” des espaces verts ont cependant rapidement fait disparaître ce foisonnement si réjouissant.a
Cela pose-t-il finalement un problème à la sécurité des citoyens que les herbes folles s’expriment, est ce à ce point intolérable qu’ un gazon devienne une prairie accueillante pour de nombreuses espèces?
Parce que la crise du Covid nous rappelle qu’une autre crise plus grave encore nous menace, celle du changement climatique et de la chute de la biodiversité.
Pourquoi préserver et favoriser la nature en ville?
Toute la végétation et en particulier les arbres avec leur cortège d’espèces animales associées fournissent à la société des services dits « éco-systémiques » tels que:
- la capture du dioxyde de carbone et donc l’atténuation du changement climatique,
- l’absorption des particules fines et donc une contribution à l’amélioration de la qualité de d’air,
- la régulation thermique grâce à « l’évapo-transpiration » des arbres permettant de lutter contre les «îlots de chaleur »,
- la lutte contre l’érosion des sols et les risques d’inondation
- l’amélioration de la qualité de l’eau par le rôle de filtrage
La présence de la nature offre de plus des bienfaits considérables pour l’équilibre psychologique de chacun, qui sont de mieux en mieux documentés.
Elle représente des lieux de convivialité et de sociabilité, de support à l’éveil de la curiosité des enfants et à l’apprentissage par tous des sciences de la vie.
La « nature en ville », ce sont aussi tous les espaces de jardins ouvriers, de jardins partagés, de jardins privés, les sites de compost, qui sont indispensables pour permettre aux citadins de cultiver un esprit de curiosité vis-à-vis du vivant.
Les bailleurs privés et sociaux ont donc également rôle à jouer dans la reconquête de la biodiversité en favorisant la nature en ville.
Avec la rédaction de chartes environnementales, la ville de Strasbourg (récompensée au niveau national) et d’autres ont amorcé un changement de vue et de pratiques envers la nature en ville; d’autres communes restent en revanche peu concernées par ces engagements.
De plus, de nombreux projets validés par les collectivités (routiers, urbain, zones commerciales, artisanales) entament régulièrement le capital vert, agricole, voire forestier du territoire EMS.
Repenser la métropole en repensant la nature en ville
Des ambitions plus grandes doivent guider les élus municipaux afin de franchir un seuil qualitatif nécessité par les enjeux environnementaux actuels et futurs.
- La nécessité de préserver les arbres anciens lors de projets d’aménagement urbain doit devenir une priorité, la compensation avec de nouveaux arbres plus jeunes étant impossible.
- Le choix des espèces à privilégier au vu de l’évolution des contraintes climatiques doit faire l’objet d’une étude attentive.
- La sanctuarisation de la trame verte et bleue existante doit devenir contraignante
- Les trames vertes et bleues inscrites dans les documents d’urbanisme doivent être réalisées en urgence
- la notion de “trame marron” doit être consacrée afin de reconquérir la qualité des sols
- L’Objectif “Zéro artificialisation nette” doit être consacré par les municipalités (Inscrit dans la loi de Biodiversité en 2018 et réaffirmée en juillet 2019 par le gouvernement) afin de permettre la “dés-imperméabilisation” des sols
- les efforts en faveur d’une “trame noire” doivent être renforcés dans l’objectif de protection de la faune en ville – la règlementation sur l’éclairage de nuit par les enseignes privées doit être rendue effective.
Repenser la métropole en repensant l’alimentation des citadins
Ce confinement à été un marqueur fort en faveur d’une alimentation saine, simple et locale.
Est ce que tendre vers une autonomie alimentaire est envisageable au niveau de l’Alsace ?
En attendant, cette crise montre la nécessité de renforcer les circuits de proximité, respectueux des écosystèmes et des animaux.
Le développement de fermes urbaines, vecteurs non seulement d’autonomie alimentaire, mais aussi de réinsertion sociale, devrait être largement étudié et mis en œuvre.
Cette alimentation en circuits de proximité (vente directe par les producteurs locaux, AMAP) doit être rendue accessible à tous par le biais d’aides et subventions publiques.
![[Enquête] Pesticides : cette toxicité qu’on nous cache](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2020/05/pesticide-zone-remplissage-1080x675.jpg)
mercredi 20 Mai 2020 | A la une, Agriculture et Alimentation, Les piques du Hérisson, Pollutions et santé, Presse
Lorsqu’un agriculteur achète et manipule un bidon de pesticides il voit une étiquette destinée à l’informer des dangers. Cette information est très codifiée, selon des règles européennes. Elle est exprimée par des codes commençant par H suivi de chiffres et d’une « phrase de danger » plus explicite, comme vous pouvez le voir sur l’exemple ci-dessous. C’est à ces phrases de danger que nous allons nous intéresser. Que vaut cette information ? Est-elle sincère et suffisante ?
Pour trouver des réponses, Anne Vonesch, avec l’aide d’Alain Bertrand, de Michèle Weisheit et de Michèle Grosjean du groupe local Bruche aval, a analysé les effets chroniques sur la santé de 89 substances pesticides (sur un total de 199) achetées en 2017 dans le secteur du code postal 67120.
Bref, c’est du concret et du local ! L’analyse consistait à comparer les dangers annoncés par les phrases de danger officielles européennes/nationales (exemple ci-dessus), aux effets à long terme sur la santé répertoriés dans deux autres bases de données, l’une anglaise, l’autre canadienne. L’écart est considérable ; c’est le résultat de tout ce travail. Par exemple, 8 % de substances actives sont cancérigènes officiellement selon les étiquettes, mais 48 % au total présentent un risque cancérigène dès lors qu’on intègre les données venant des deux autres sites. Jamais les phrases de danger officielles ne mentionnent un effet toxique sur le foie, jamais une perturbation endocrinienne.
Découvrez la suite… et apprenez pourquoi, après le dernier avis de l’ANSES datant de cet avril, le gouvernement devrait prendre son courage entre deux mains et respecter son propre arrêté du 27 décembre 2019, à savoir : imposer une distance minimale incompressible par rapport aux riverains de 20 m pour les 126 perturbateurs endocriniens listés par l’ANSES. Tout en accélérant la sortie des pesticides, notamment avec les outils de la PAC.
Cette enquête vous introduit aussi dans l’usine à gaz des règlementations et dans le « mythe de l’usage sûr » des pesticides. Et les riverains ? Qu’ils applaudissent les paysans bio en achetant leurs produits !
Télécharger l’intégralité de notre enquête – PDF (3,3 Mo)


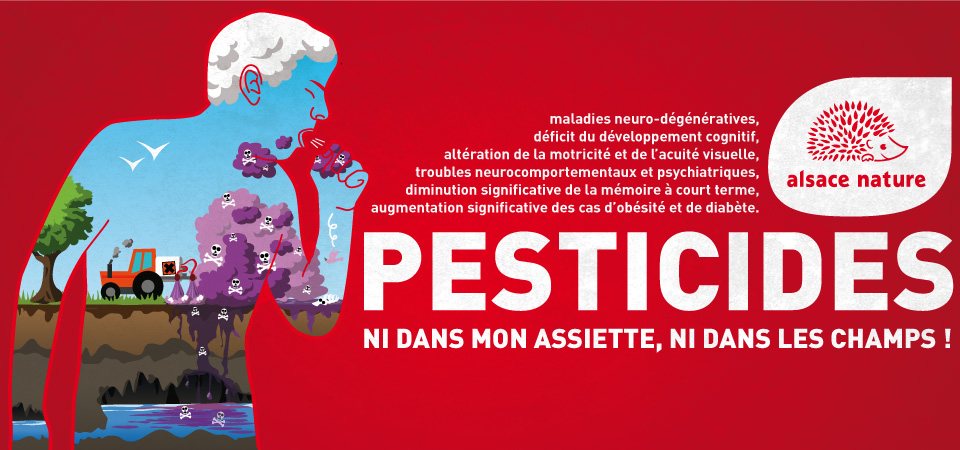

![[Enquête] Pesticides : cette toxicité qu’on nous cache](https://alsacenature.org/wp-content/uploads/2020/05/pesticide-zone-remplissage-1080x675.jpg)